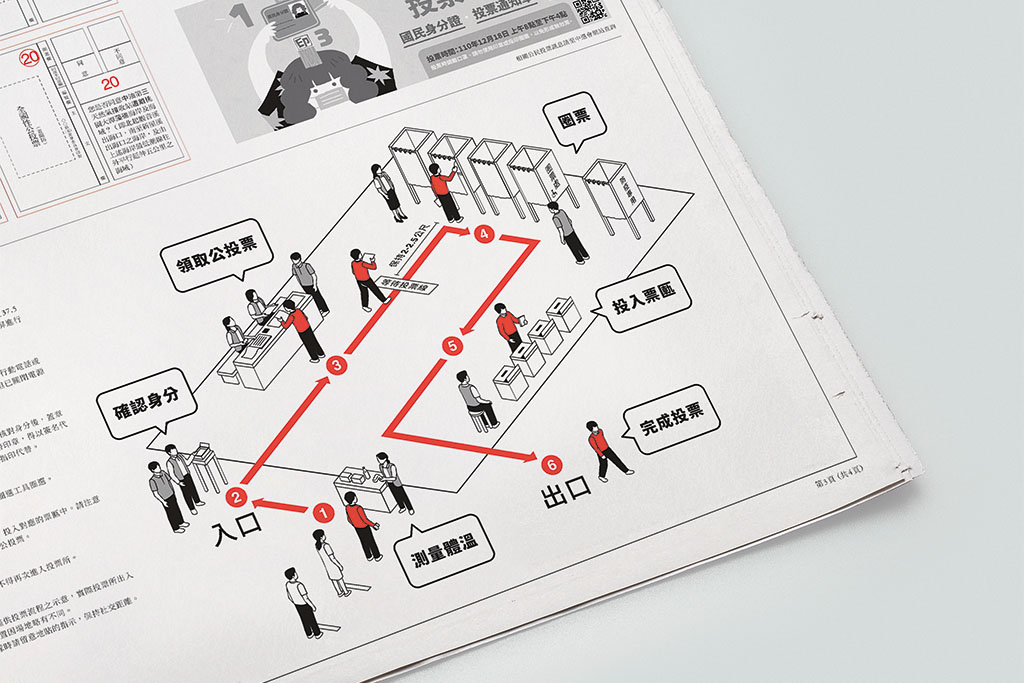Vers un béton "durable" ?
Pour accompagner sa politique de recherche & développement autour d’un béton décarboné, le groupe cimentier Holcim propose toute une gamme de solutions innovantes pour les constructions d’aujourd’hui et de demain. Du design et des systèmes intelligents qui repensent le bâti des structures (pont Striatus), des sols (Rippmann Floor System) aux toits végétalisés (green roofing), quand il ne s’agit pas de la construction de la maison elle-même en 3D !
Les problématiques de développement durable et d’économie énergétique mettent les grands groupes de la construction face à de nouveaux enjeux majeurs. C’est le cas notamment du groupe cimentier Holcim, leader mondial des matériaux et des solutions de construction (en particulier depuis sa fusion avec l’entreprise française Lafarge), qui est entré dans une stratégie globale de projets innovants visant à la décarbonation du béton, tant dans sa production (solutions de construction vertes, principes de recyclage) que dans la mise au point d’une nouvelle génération de technologies. « On construit l’équivalent d’un New York tous les jours », explique Edelio Bermejo, directeur du département R&D d’Holcim. « Et 60 % de l’urbanisme nécessaire à loger la population à venir est encore à venir. Nous avons donc un énorme besoin de béton, et pour que cette offre soit cohérente, ce béton doit être de plus en plus durable. »
Du béton « durable », c’est quoi ?
Concrètement, un béton « durable » est d’abord un béton plus axé sur les produits locaux, pierres et granulats, entrant dans sa composition, pour des questions de circuits courts bien compréhensibles. La recherche sur de nouvelles compositions et procédés de fabrication menés dans le département R&D d’Holcim à Lyon, en partenariat avec tout un écosystème innovant de start-up et de grandes écoles (MIT, Ecole des Ponts, Paris Tech), et à travers les gammes de béton et ciment durables ECOPact et ECOPlanet, est une autre option. Elle permet de créer des constructions avec du béton moins friand en CO2 et avec une empreinte carbone réduite de 30 à 100% (comme cela est le cas pour les Sphères de Seattle, des dômes de verdure intégrant un vaste complexe de bureaux construit au cœur de la ville). L’éventuel hausse du coût du béton qui en résulterait n’est pas un souci. Actuellement, le coût moyen du béton ne représente que 4,7% du prix d’un bâtiment (alors qu’il constitue 73 % de sa masse). Une simple hausse de 20% de son coût ne représenterait donc que 6% du prix total du bâtiment, ce qui est largement amortissable à la condition de le décarboner.
Une autre solution porteuse réside dans les recherches en recyclage du béton existant : un principe de construction circulaire qui réduit automatiquement l’impact carbone procédant de la fabrication de nouveau béton et qui implique peu de coût d’énergie pour transformer le béton récupéré, sans perte de qualité technique. « Le principal coût est le transport », expose Edelio Bermejo qui concède toutefois un nécessaire « changement de mentalité » chez les clients. En Suisse, beaucoup semblent déjà convaincus, et le ciment Susteno, le premier ciment au monde conçu avec 20% de matériaux recyclés, est déjà disponible sur le marché helvète.

Si vous ajoutez à cela tout un faisceau de recherches technologiques (captation et stockage du CO2 dégagé par la production de béton – par exemple pour produire du kérosène synthétiques ; béton connecté ou béton magnétisable, permettant de charger la batterie de votre téléphone voire celle d’un bus ; béton hydromedia, pour des sols absorbant les eaux de pluie, comme cela est déjà le cas dans un parc d’Aubervilliers), la myriade de pistes en cours de développement ou déjà opérationnelles donne le tournis.
De nouveaux systèmes de construction intelligents
Pourtant, cette stratégie d’ensemble autour du béton durable et décarboné, ne repose pas que sur le matériau lui-même. Du côté d’Holcim, on a choisi de faire aussi appel au design pour promouvoir de nouveaux systèmes de construction intelligents, susceptibles en particulier de faciliter l’assemblage et de réduire la masse de matériau nécessaire à la réalisation de la surface souhaitée. Une réflexion qui passe par tous les aspects du bâti, des toits aux sols des bâtiments, et jusqu’au mobilier urbain.

Pour la couverture, Holcim propose sous la marque Firestone, toute une série de systèmes de toits végétalisés particulièrement intéressants pour rafraîchir et isoler les habitations dans des villes où le poids de l’urbanisme a été très fort ces dernières années, en Asie particulièrement. Les 22 000 mètres carrés de toits de l’Université Tammassat, à côté de Bangkok en Thaïlande, accueillent donc grâce au principe de membrane thermoplastique Ultrafly TOP tout un système de fermes en cascade qui participent à absorber naturellement les eaux de pluie, à réduire l’effet de chaleur urbaine, à offrir un circuit court de production agricole et à lutter contre la déperdition énergétique passant généralement par les toits (en moyenne 60% de perte).
Du côté des planchers, Holcim s’est associé avec le Block Research Group (BRG) de l’ETH-Zurich pour développer un innovant système de sols très léger en poids et facilement montable/démontable. Le Rippmann Floor System s’assemble en effet aisément du fait de son aspect géométrique en blocs d’arches, tous de la même forme et modulables les uns avec les autres. Ce système évite l’appoint de renforcement intégré en acier, ce qui favorise le recyclage. La forme des blocs utilisés leur permet d’être moins dense, en incorporant des parties vides qui rendent les structures à la fois moins lourdes et plus écologiques. L’utilisation de matière est en effet réduite de moitié et grâce à l’usage de béton vert ECOPact et de ciments vert ECOPlanet, l’empreinte carbone s’en voit diminuée.

En termes de structure, le pont Striatus a été particulièrement remarqué lors de la dernière biennale d’architecture de Venise. Comme le Rippmann Floor System – il a lui aussi été conçu avec l’ETH de Zurich notamment – il procède d’un assemblage de blocs uniques (53 en l’occurrence), spécialement designés pour tenir ensemble grâce à des points de compression et de gravitation. Il n’utilise donc aucune colle ou jointure. Chaque élément est placé à l’endroit précis pour permettre là aussi une utilisation minimale de béton décarboné. Ce calcul extrêmement précis et sa fabrication très technique résulte là encore de l’utilisation d’imprimantes 3D. Une démarche étonnante qui permet à Holcim d’imaginer des schémas de production/commercialisation… et d’ouvrir encore de nouvelles perspectives.
Des imprimantes 3D bâtisseuses
En effet, Holcim place l’utilisation d’imprimantes 3D au cœur de plusieurs projets d’architecture et de systèmes de construction intelligents menés à l’international et particulièrement en Afrique grâce à sa filière 14trees. Au Malawi, une école entière a été conçue en 2021, grâce à ce système de chantier technologique rapide et économe en matière. Les images sont impressionnantes. Imaginez une imprimante géante traçant en aller-retour, puis sur tout le pourtour d’une forme rectangulaire, l’empilement des infrastructures murales en béton nécessaires à l’édification d’une vraie maison !

18 heures ont été nécessaires à cette conception record qui en appelle bien évidemment d’autres. Au Kenya, pour permettre de répondre à la demande de construction rapide de logement, Holcim vient tout juste de lancer un ambitieux projet de 52 unités d’habitation construites grâce à l’impression 3D. Une pierre supplémentaire dans le jardin du béton durable et décarboné.



.svg)