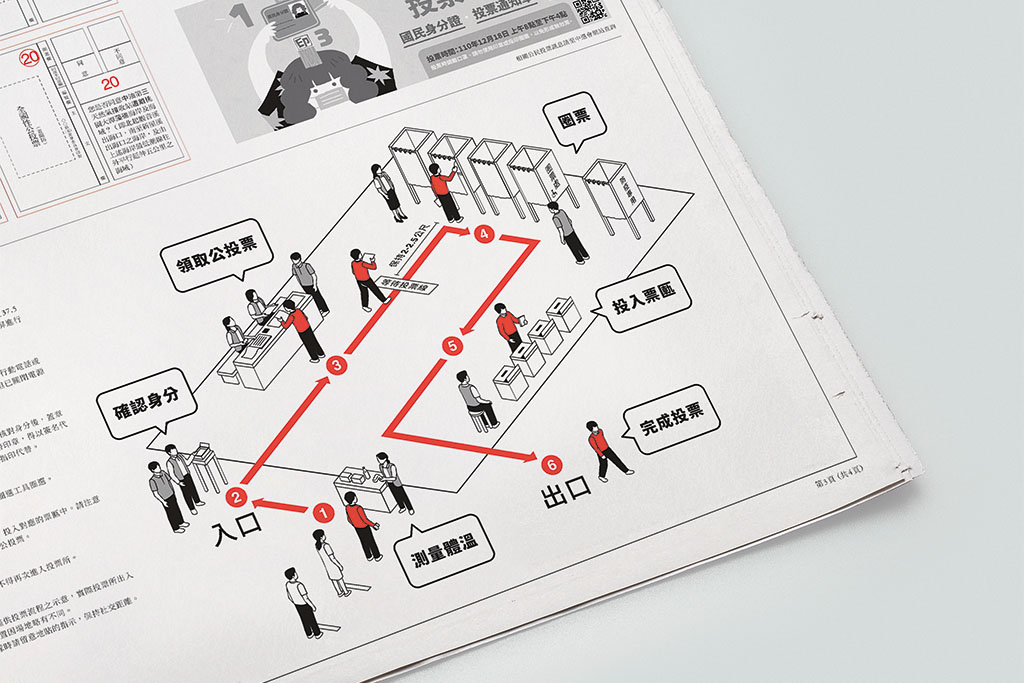Prolongation de l'exposition "Home Stories : 100 ans, 20 intérieurs visionnaires" jusqu'en 2021
L’exposition “Home Stories : 100 ans, 20 intérieurs visionnaires” est prolongée jusqu’au 28 février 2021 au Vitra Design Museum. Fermée temporairement lors de la crise de coronavirus, elle illustre les évolutions sociales, sociétales et politiques de l’intérieur moderne.
Un intérieur est le reflet d’un style de vie, d’un quotidien et d’une époque. Avec “Home Stories : 100 ans, 20 intérieurs visionnaires”, le fabricant suisse de mobilier Vitra présente l’évolution de l’intérieur moderne et invite à réfléchir sur les perspectives d’avenir – qui revêtent une dimension d’actualité nouvelle avec la crise de coronavirus. Les dessins d’architectes comme Adolf Loos, d’architectes d’intérieur comme Elsie de Wolfe ou d’artistes comme Andy Warhol illustrent les bouleversements historiques qu’a connu l’intérieur depuis le début du XXe siècle – les plans d’étage ouverts dans les années 1920, l’apparition de l’électroménager moderne dans les années 1950 et la découverte du loft dans les années 1970.
Espace, Economie et Atmosphère : 2000 – Aujourd’hui

Les premiers intérieurs de l’exposition reflètent la radicalité des changements actuels observés dans les intérieurs privés. En effet, la hausse des prix de l’immobilier et la pénurie d’espace de vie abordable qui en résulte favorise la conception de micrologements et leurs meubles convertibles. On peut le voir notamment à travers « Yojigen Poketto » (qui se traduit par « poche 4D »), un appartement conçu par le studio d’architecture Elii à Madrid (2017).
Dans le même temps, les projets de reconversion, comme « Antivilla » d’Arno Brandlhuber près de Berlin (2014) – qui utilise du textile comme des cloisons mobiles – offrent des stratégies pour optimiser efficacement l’espace et présentent une nouvelle définition du confort et du luxe, basée sur la simplicité et le langage des matériaux.
La pertinence de l’économie du partage, qui se reflète dans la décoration intérieure, est elle illustrée par le projet « Granby Four Streets Community Housing » à Liverpool (2013 – 17), initié par le collectif multidisciplinaire Assemble. En étroite collaboration avec les habitants potentiels, Assemble a sauvé une terrasse d’une maison victorienne de la déchéance urbaine, a redessiné les intérieurs pour les besoins contemporains, et a aidé à mettre en place un atelier qui réutilise des matériaux de construction pour créer l’ameublement des nouveaux espaces.
Aujourd’hui, les plateformes Internet comme Airbnb, Instragram et Pinterest alimentent la perception d’un intérieur comme marchandise, qui peut être affichée et capitalisée à tout moment. Toutefois, l’imagerie et les stratégies d’affichage dans de nombreux intérieurs privés remontent à la période prémoderne ou même des traditions d’habitation vernaculaires. On peut le voir dans un diaporama de Jasper Morrison exclusivement commandée pour l’exposition, qui explore comment l’agencement des objets affecte fondamentalement le caractère et l’atmosphère d’un espace privé.
Repenser l’intérieur : 1960 – 1980

La deuxième partie de l’exposition se penche sur les changements radicaux de la décoration intérieure des années 1960 à 1980. Avec la diffusion du postmodernisme, les concepteurs, et particulièrement le groupe de design Memphis, commencent à réfléchir à la signification symbolique de l’ameublement, des motifs et des décorations.
Collectionneur passionné des créations de Memphis, le créateur de mode Karl Lagerfeld fait de son appartement à Monte-Carlo une salle d’exposition postmoderne au début des années 1980.
Au cours des deux décennies précédentes, les bouleversements sociaux se sont répercutés sur l’intérieur des maisons. En collaboration avec le philosophe Paul Virilio, l’architecte Claude Parent introduit le concept de « l’oblique » pour contrer les espaces neutres et cubiques qui prévalent à l’époque. Parent meuble son propre appartement à Neuilly-sur-Seine avec des plans inclinés qui peuvent servir indifféremment de siège, de salle à manger ou de lieu de travail, ou encore de lit de jour.
La New York Silver Factory d’Andy Warhol (1964-1967) est un exemple parfait des premiers loft, devenant un symbole presque mythique de l’atelier de l’artiste en tant que combinaison de l’espace de vie et de travail.
Au même moment, le fabricant de meubles et l’entreprise de vente au détail IKEA est sur le point de révolutionner l’industrie avec son programme visant à fournir des meubles modernes aux masses. L’ascension d’IKEA au rang de plus grand fabricant et détaillant de meubles au monde a contribué au changement perception des meubles – d’un objet qui se transmet de génération en génération, il devient un produit de consommation éphémère, jetable et rapidement dépassé.
Les années 1960 et 1970 présentent des idées radicales de décoration intérieure. Le “Paysage de fantaisie » de Verner Panton (1970) était composé d’éléments rembourrés de différentes couleurs qui formaient un tunnel en forme de grotte. Cette installation est reconstituée, le temps de l’exposition, dans la caserne de pompier de Zaha Hadid attenant au musée. Devant le musée, la micromaison “Hexacube” de George Candilis (1971) montre comment la préfabrication, la modularité et la mobilité ont façonné les notions de domesticité.
Nature et technologie : 1940 – 1960

Une autre époque décisive dans la formation de l’intérieur moderne a été celle de l’après-guerre. Cette période est marquée par l’entrée du style moderne, développée avant la Seconde Guerre mondiale, dans les intérieurs du monde occidental. Pendant la guerre froide, la concurrence politique entre l’Est et l’Ouest se cristallise autour de la question du niveau de vie, avec pour point culminant le fameux « débat sur la cuisine » entre Richard Nixon et Nikita Khrouchtchev qui a eu lieu dans une maison préfabriquée américaine exposée à Moscou en 1959.
Avant cela, le milieu du XXe siècle a vu le langage de l’intérieur moderne se raffiner. La « Maison du futur » conçue par Peter et Alison Smithson pour l’exposition Ideal Home à Londres en 1956 embrasse les méthodes de préfabrication et l’automatisation des ménages, y compris les derniers appareils de cuisine et le bain autonettoyant. Beaucoup plus sceptique à l’égard des progrès technologiques et du design fonctionnaliste, Jacques Tati, dans son film « Mon Oncle » (1958), met en scène la Villa Arpel comme une maison aseptisée avec un esprit propre, dominant ses habitants.
En combinant des formes et des matériaux modernes avec un sentiment de « chez soi », les intérieurs scandinaves deviennent de plus en plus influents, comme en témoigne la résidence privée de l’architecte Finn Juhl (1942). Il a utilisé sa propre maison, à Ordrup au Danemark, comme intérieur test : les meubles sont conçus pour explorer la façon dont ils peuvent s’intégrer dans un intérieur.
De plus, « vivre avec la nature » et les « frontières fluides » entre l’intérieur et l’extérieur deviennent des sujets clés pour les architectes comme Lina Bo Bardi et sa Casa de Vidro à São Paolo, au Brésil (1950/51). Bernard Rudofsky, un autre architecte qui envisage la relation entre l’habitation privée et son environnement naturel, s’inspire des traditions de construction vernaculaires pour promouvoir les maisons avec des pièces extérieures. Avec l’artiste Costantino Nivola, il crée un espace de vie extérieur appelé « Nivola House Garden » à Long Island, New York (1950).
La naissance de l’intérieur moderne : 1920 – 1940

Les années 1920 et 1930 voient l’émergence de plusieurs concepts clés d’espace et de décoration d’intérieur qui prédominent encore aujourd’hui. Dans ces premières années de la conception moderne, pourtant si différent de celui d’aujourd’hui, l’intérieur privé est au centre du débat architectural. C’est illustré à très grande échelle par le programme de logements sociaux « Das Neue Frankfurt » (1925-30). Dirigé par l’architecte Ernst May, il comprend la cuisine de Francfort de Margarete Schütte Lihotzky (1926), mais aussi des meubles abordables conçus par Ferdinand Kramer et Adolf Schuster.
Alors que May poursuit un programme social fort, d’autres architectes réinventent la répartition et la polyvalence de l’espace domestique. Dans sa villa Tugendhat à Brno, en République tchèque (1928-30), Ludwig Mies van der Rohe crée l’une des premières maisons basées sur un concept d’espace ouvert, avec des espaces fluides dans lesquels des meubles et des textiles soigneusement placés créent des îlots pour différents usages.
Adolf Loos défend plutôt le « Raumplan », un concept d’aménagement du territoire qui ne pouvait être compris en deux dimensions en raison de sa complexité tridimensionnelle. Sa villa Müller à Prague (1929-30) présente une séquence soigneusement chorégraphiée d’espaces à différents niveaux et de différentes hauteurs, qui dépassent la notion standard de plancher à un seul plan. Son compatriote autrichien, architecte et designer Josef Frank introduit le concept d’ »accident », selon lequel les intérieurs se développent organiquement au fil du temps et semblent composés par hasard.
Contrairement à ces positions modernistes, certains de leurs contemporains adoptent l’ornementation comme moyens d’expression. Elsie de Wolfe, qui a publié son livre « The House in Good Taste » en 1913, est souvent considérée comme l’une des premières décoratrices d’intérieur professionnelles. De Wolfe préconise l’aménagement intérieur comme une représentation de l’identité de la personne qui y vit. Cela est également vrai pour les intérieurs créés par le photographe et architecte d’intérieur Cecil Beaton qui utilise son cadre domestique comme un moyen de l’expression de soi. Pour sa « Maison Ashcombe » (1930 – 45), il s’est inspiré des arts, du théâtre, et même le cirque.

Tout au long du XXe siècle, le débat sur l’aménagement intérieur a évolué entre les concepts opposés de la normalisation, du fonctionnalisme et de la réduction formelle d’une part, et de l’individualisation et de l’ornementation d’autre part, qui continuent tous deux à façonner nos foyers en ce sens jour. L’exposition « Home Stories » revisite certains des moments décisifs de cette évolution et pose la question pour aujourd’hui : comment voulons-nous vivre ?
« Home Stories : 100 ans, 20 intérieurs visionnaires »
8 février 2020 – 28 février 2021
Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2
79576 Weil am Rhein
Allemagne



.svg)