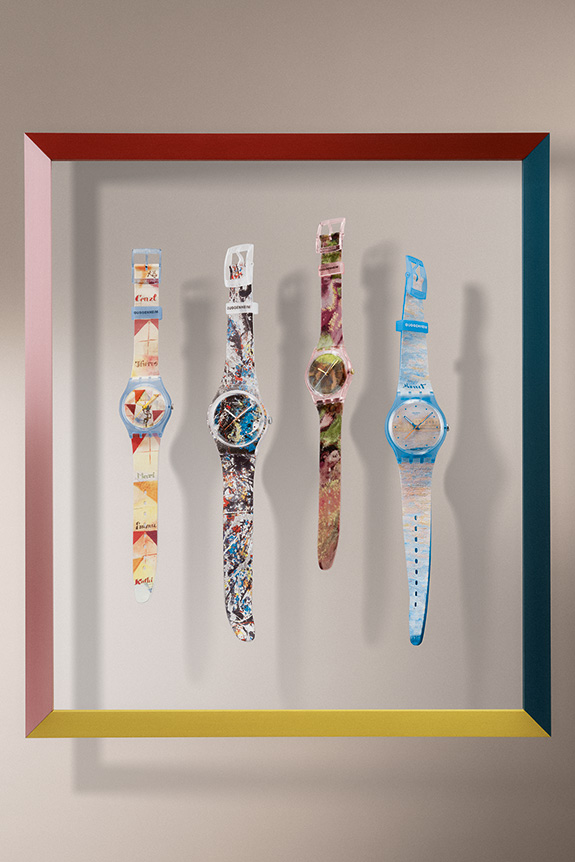Mini : Electric feel
Depuis soixante-cinq ans, Mini traverse les décennies sans ne jamais rien perdre de son charme ni de son unique personnalité. Les récentes versions 100 % électriques illustrent subtilement la capacité de la marque à proposer des nouveautés plus que jamais dans l’air du temps, sans trahir ses origines.
Mise à jour : Découvrez en vidéo notre essai design du nouveau Mini Countryman SE.
Mini Story
Il est tout d’abord essentiel de bien distinguer deux grandes ères de Mini : l’originale, née en 1959 et fabriquée jusqu’en 2000, puis toutes les variantes produites à partir de 2001 sous la direction du groupe allemand BMW. La British Motor Corporation (BMC) lança la Mini en 1959 en répondant à un cahier des charges guidé par la recherche d’efficience tant en matière de gabarit, de sobriété en carburant qu’en termes d’optimisation du process de fabrication. Le design de la Mini, dont Alec Issigonis eut la responsabilité, revendique un style simple mais surtout remarquablement efficace, offrant un large espace intérieur pour un encombrement extérieur des plus réduits. L’optimisation de l’architecture (communément appelée « package » dans le jargon des designers) est restée sans égale dans les voitures de série et demeure, encore aujourd’hui, LA référence. Il est bien sûr à noter que les Mini du troisième millénaire sont très sensiblement plus grandes et massives du fait notamment des normes draconiennes de sécurité imposant l’intégration d’organes spécifiques.

Extérieurement, le style originel de la Mini est facilement reconnaissable, se caractérisant par une silhouette bicorps (sans malle arrière) et un capot court du fait de la position transversale du groupe motopropulseur. Afin d’optimiser l’espace intérieur, les roues sont positionnées aux quatre coins de la voiture attribuant une grande stabilité visuelle à l’ensemble. La face avant est expressive avec sa grande calandre ornée de deux grands phares ronds. Ces derniers, équipant d’autres véhicules de taille standard, paraissent particulièrement grands sur cette toute petite auto, lui conférant une bouille singulière et attachante. Le pavillon est quant à lui composé d’une seule pièce, simple à fabriquer en grande série, et assemblé de façon uniforme à l’habitacle où une gouttière contourne l’ensemble du toit. Cette conception, initialement guidée par l’ingénierie, sépare visuellement le panneau de toit du reste de la voiture. La pièce de carrosserie se compose ainsi d’un seul grand élément qui semble être en lévitation au-dessus de la voiture, permettant d’innombrables personnalisations graphiques, dont l’incontournable Union Jack.

À l’intérieur, seul un gros compteur de vitesse trône au centre de la planche de bord, donnant aux premières versions une réelle personnalité visuelle, à une époque où les planches de bord étaient particulièrement spartiates et dépouillées. Depuis, le dessin de la planche de bord a toujours été organisé autour de cet élément graphique central et circulaire, jadis simple tachymètre analogique, aujourd’hui écran multimédia aux nombreuses fonctions. La Mini, commercialisée durant quarante années sous plusieurs marques et dénominations commerciales (Austin, BMC, Morris, etc.), fut produite à plus de cinq millions d’exemplaires, la gratifiant du titre de voiture britannique la plus vendue au monde.
Pionnière du néo-rétro
C’est en 2001 que BMW lance enfin la nouvelle génération de Mini avec pour ambition ultérieure de développer une marque à part entière. Si la Mini du XXIe siècle n’a techniquement plus rien à voir avec son illustre aïeule, elle en réinterprète subtilement les codes pour en faire une voiture à la conception moderne, proche des modèles de la concurrence en termes d’architecture, mais arborant un style néo-rétro finement orchestré, sans jamais tomber dans la caricature boursoufflée. Car si le gabarit a changé, les proportions sont restées semblables : carrosserie bicorps, quatre roues aux quatre coins, large calandre entourée de deux grands phares avant expressifs complétées d’astuces en trompe-l’oeil, à l’image des montants de l’habitacle laqués en noir brillant qui se fondent dans les vitrages teintés, donnant au toit, particulièrement dans les versions bi-tons ou personnalisées, un aspect flottant. Au fil des ans et des multiples évolutions techniques et stylistiques, de nouveaux modèles sont apparus (Clubman, Countryman, Paceman, etc.), constituant une gamme de véhicules urbains et extra-urbains uniques sur le marché.

Virage électrique
Uniquement disponible en motorisation électrique, ce qui explique son appellation, la Mini Cooper SE 2024 dégage à la fois compacité, agilité et dynamisme. Les codes « ancestraux » Mini sont respectés, la voiture est bien campée sur ses roues, ses porte-à-faux avant et arrière sont ultra-courts, sa face avant dévoile de grands phares et une grande calandre pleine (à l’exception de sa partie inférieure). Les flancs sont toujours traités avec simplicité et sobriété et des feux arrière originaux intègrent avec finesse un graphisme dessinant l’Union Jack. Mais c’est incontestablement l’habitacle de la Mini Cooper SE qui innove le plus. Au coeur du tableau de bord, un écran central à technologie OLED la dote d’une apparence unique, servant tout autant de combiné d’instruments que d’assistant personnel menant à de multiples fonctionnalités multimédias.

L’utilisation inédite d’un nouveau textile, tricoté selon une technique 2D unique, recouvre planche de bord et panneaux de porte, constituant un support optimal pour des projections lumineuses propres aux différents Modes d’Expérience MINI. Fidèle à ses qualités originelles, l’ensemble de l’habitacle est hautement optimisé et dégage une immédiate sensation d’espace au regard de l’encombrement général de la voiture. Le lancement de la nouvelle Mini Cooper SE s’accompagne de celui de la nouvelle Countryman SE. Celle-ci livre une autre interprétation des codes de la marque avec un style plus marqué, plus rugueux, tout en étant adapté, du fait de son architecture électrique, aux nouveaux usages polyvalents.

Retrouvez cet article dans le numéro 218 d'Intramuros, disponible dès maintenant.



.svg)