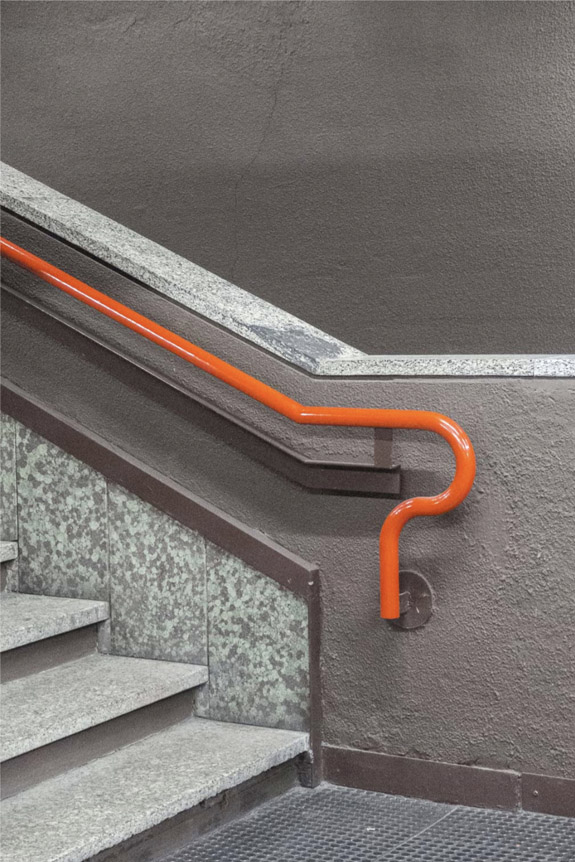Les leçons de l’Art déco
Art déco en France et Art déco outre-Atlantique, deux appellations pour un style moderniste s’efforçant de mettre de l’art dans tout. La Cité de l’architecture remet à l’honneur ce style, espérant toujours sa reconnaissance officielle.
« L’Art déco est méprisé », déplore Emmanuel Bréon, commissaire de l’exposition « Art déco, France-Amérique du Nord », actuellement présentée à la Cité de l’architecture. Pas une œuvre Art déco au MoMA (musée d’Art moderne de New York), ni dans les collections des grands musées français. Quant au quasi homonyme musée des Arts décoratifs, il couvre un spectre bien plus large dans les arts appliqués. Rayon de soleil dans ce paysage désolé, les beaux succès en salles des ventes d’un Jacques-Émile Ruhlmann ou d’un Pierre Chareau, et une curiosité du grand public pour le genre, avec des parcours urbains à Saint-Quentin, Roubaix, Lens, Clichy, et ailleurs, sans parler des Art Deco Societies, qui pullulent outre-Atlantique.
Comme l’Art nouveau, péjorativement appelé « art nouille » jusqu’à sa réhabilitation par le musée d’Orsay, l’Art déco va-t-il recevoir sa consécration officielle et sortir du purgatoire critique où il moisit depuis tant d’années ? Retracer la généalogie de ce mouvement n’est pas aisé, et en appuyant d’emblée sur le lien entre Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique compris) avant de définir ledit Art déco, l’exposition ne contribue pas à clarifier la situation. Pour une fois, l’Art déco ne serait pas une nouveauté d’Amérique, à l’instar des hôtels ou des gratte-ciel. Né en Europe, il aurait franchi l’Atlantique avec les soldats américains démobilisés, étudiant dans des écoles spécialisées de Fontainebleau ou de Meudon en attendant leur retour au pays. Mais apprenaient-ils les ressorts d’un nouveau style moderne ou testaient-ils un avatar de l’enseignement de l’École des beaux-arts, alors à son apogée ? Mouvement sans manifeste, ni véritable chef de file, l’Art déco n’aurait, selon certains auteurs, reçu son nom qu’en 1966, à l’occasion d’une exposition au musée des Arts décoratifs. L’exposition de 1925, moment majeur pour les arts publics en France, passe aussi pour sa date de naissance. Brièvement abordé, car déjà objet d’une exposition dans les mêmes murs en 2013, la manifestation ne faisait que cristalliser des pratiques apparues à l’aube du XXe siècle. Le temps de l’Art déco semble courir des années 1900 jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale, avec une diffusion internationale, notamment outre-Atlantique, au centre de l’exposition.


L’art universel
L’aspect encore aujourd’hui le plus captivant de l’Art déco tient à cette volonté d’inventer une forme artistique applicable à tous les arts, purs ou appliqués, de l’architecture à la peinture, en passant par le textile, le mobilier, la sculpture ou le cinéma. Il apparaît comme la dernière incarnation de l’œuvre d’art totale, suivant un principe né en Allemagne au XIXe siècle avec le théâtre wagnérien appliquant la création à toutes les échelles. L’Art déco s’attache au lien entre art, artisanat et économie, autre principe germanique qui aboutira à la création du Bauhaus, mais pas plus en France qu’aux États-Unis il n’aura d’école aussi emblématique. Le soutien de l’État français à l’art décoratif, perçu comme un élément d’excellence de l’économie nationale, est perceptible dans l’exposition de 1925, puis l’Exposition universelle de Paris en 1937. Exposition permanente, les grands paquebots servent autant au transport de voyageurs que de vitrines des savoir-faire français. Une cimaise présente la coupe l’une de ces villes flottantes qui fascineront bien des architectes, et donne un aperçu des décors des salles à manger de l’« Île-de-France » (1927) ou de son rival plus prestigieux, le « Normandie » (1935). Le passager traverse l’Atlantique dans une œuvre d’art flottante et praticable, un décor travaillé jusqu’à l’excès par Ruhlmann, Louis Süe et André Mare, le sculpteur Alfred Janniot et le peintre Jean Dupas, pour n’en citer que quelques-uns. « Le plus beau seau à champagne du monde », aurait dit la presse de l’époque en parlant de l’« Île-de-France ».

Sur la terre ou sur les mers, l’Art déco est d’abord l’art de la haute bourgeoisie. Il se développe dans les hôtels particuliers. Il élabore son vocabulaire en toute liberté dans ces univers privés où s’inventent de nouvelles façons de travailler le verre ou le fer, où l’on choisit les motifs et où l’on travaille leur stylisation. Aucune surprise, donc, que l’Art déco se retrouve sur les enseignes des grands magasins de luxe new-yorkais quand il traverse l’Atlantique. Ce langage de l’élite se démocratise après la crise de 1929, pour gagner l’habitat populaire et le mobilier. La corbeille de fruits stylisée va triompher sur les garde-corps, les frontons et les colonnes, éclipsant la vieillotte et compliquée feuille d’acanthe des chapiteaux corinthiens. L’Art déco offre à un monde en crise la possibilité d’avoir un ornement moderne, économique et passe-partout.

Streamline, ou les origines Art déco du design
Les peintures du Mexicain Angel Zárraga comptent parmi les belles découvertes de l’exposition. Son installation en France dès 1904 n’en fait pas le sujet le plus représentatif de l’Art déco du Nouveau Monde. Après les grands magasins et l’univers du luxe, la diffusion du mouvement et sa popularisation outre-Atlantique s’opèrent grâce aux objets accompagnant l’essor de la consommation de masse épousant le style « streamline », lui aussi méprisé des musées et des critiques. Inventé par des figures comme Donald Deskey, Walter Dorwin Teague ou Raymond Loewy, prototypes du designer industriel, le style s’identifie à trois « traits de vitesse » qui seraient empruntés à la bande dessinée. Ils impriment une idée de mouvement à des objets qui n’en ont aucunement besoin, tant qu’ils ne sont pas utilisés comme projectiles : taille-crayon, lampe, radiateur… Les études aérodynamiques développées dans l’aéronautique, appliquées aux locomotives et aux automobiles, expliquent aussi la genèse de ces formes, et les traits figurent l’écoulement d’air visualisé en soufflerie. Le développement de matériaux artificiels, tels que le Lloyd Loom, ersatz du rotin utilisé pour la fabrication de meubles dans les zeppelins et les transports aériens naissants, annonce l’apparition de contraintes de légèreté et l’arrivée de nouveaux matériaux synthétiques qui changeront peu à peu la donne en matière de design.


L’architecture absente
Si les nombreuses sculptures et les peintures de l’exposition raviront le visiteur, suffiront-elles à le consoler de voir aussi peu d’architecture dans les murs d’une institution qui y est dédiée ? Où sont les polémiques déclenchées par ce style ? Elles étaient pourtant animées, en témoigne l’ouvrage « L’Art décoratif d’aujourd’hui », publié par Le Corbusier en 1925. Une condamnation sans appel d’un Art déco qu’il juge superflu. « L’art décoratif moderne n’a pas de décor », disait l’architecte. Où sont les Faure-Dujarric, Henri Zipcy, Henry Trésal, ou, aux États-Unis, les Arthur Peabody, Ralph Walker, Van Alen ? Où sont les immeubles d’habitation, les grands magasins, les pavillons de l’Exposition de 1925, l’ambassade du Mexique, dévoilée en avant-première lors de l’exposition puis oubliée ? L’architecture se borne à trois exemples intéressants, mais souvent périphériques ou déjà très connus, à l’instar du palais de Chaillot, qualifié de washingtonien, et à la figure de Jacques Carlu, architecte américanophile installé un temps aux États-Unis. Pas de quoi comprendre les débats, ni restituer la richesse de ce patrimoine oublié, et de ce fait toujours menacé. Signe que, plus encore que l’Art déco, l’architecture peine à accéder à la considération critique ?



.svg)